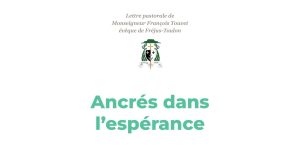Lettre Pastorale de Monseigneur François Touvet

Frères et sœurs du diocèse de Fréjus-Toulon,
Dans la bulle d’indiction du Jubilé « L’espérance ne déçoit pas », le pape François reprend à la Lettre aux Hébreux l’image évocatrice de l’ancre comme symbole de l’espérance :
« L’image de l’ancre évoque bien la stabilité et la sécurité que nous pos-sédons au milieu des eaux agitées de la vie si nous nous en remettons auSeigneur Jésus. Les tempêtes ne pourront jamais l’emporter parce que nous sommes ancrés dans l’espérance de la grâce qui est capable de nous faire vivre dans le Christ en triomphant du péché, de la peur et de la mort. Cette espérance, bien plus grande que les satisfactions quotidiennes et l’amélioration des conditions de vie, nous porte au-delà des épreuves et nous pousse à marcher sans perdre de vue la grandeur du but auquel nous sommes appelés, le Ciel. Le prochain Jubilé sera donc une Année Sainte caractérisée parl’espérance qui ne passe pas, l’espérance qui est en Dieu. »
Cette ancre figure dans le blason épiscopal que je porte depuis neuf ans, alors que j’étais ordonné évêque au cœur d’une Année Sainte de la miséricorde le 28 février 2016. Elle est gravée dans mon cœur. À peine le Jubilé ordinaire 2025 était-il ouvert que je recevais par succession la charge pastorale de notre Église diocésaine. J’accueille avec humilité et dans l’action de grâce ce signe du Seigneur au cœur d’une Année Sainte dont l’espérance est le fil conducteur. Je m’engage à exercer mon ministère en « pèlerin d’espérance » (thème du Jubilé 2025), d’autant qu’une tempête a secoué la barque du diocèse. Le Seigneur nous appelle à la confiance pour que les vents et la mer se calment. Et c’est aussi vrai plus largement : le contexte géopolitique actuel génère des angoisses et des violences. L’instabilité générale réclame ce sursaut d’espérance.
Comme je l’ai exprimé à l’issue de la messe d’action de grâce et d’adieu de Monseigneur Rey le 1er février à La Castille, je m’inscris dans la continuité parce que c’est la réalité de la succession apostolique. Parce que c’est aussi la réalité de l’humanité, je le fais et le ferai avec la nouveauté de ce que je suis, ma personnalité, mon histoire, ma formation, mon âge, mon expérience pastorale, et surtout avec vous tous. Passionné par la mission et l’évangélisation, je reprends volontiers la vision diocésaine : « Une communion missionnaire à bâtir ensemble ». Cette expression ne doit pas rester un slogan ou une formule magique. Nous devons chercher à la mettre en œuvre, vraiment. En cette Semaine Sainte où nous célébrons le cœur de la foi chrétienne, le mystère de notre salut par la mort et la résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ, je souhaite vous partager mes réflexions pastorales pour aujourd’hui et demain, ouvrir quelques chantiers à mener avec vous, et tracer la route pour l’avenir. Rassemblés bientôt pour le pèlerinage jubilaire diocésain le 1er mai prochain sur le tombeau de sainte Marie-Madeleine, « apôtre des apôtres » et patronne principale de notre diocèse, nous invoquerons le Saint-Esprit pour écrire ensemble les nouvelles pages de l’histoire sainte du Var.
En février dernier, j’ai eu la joie de participer à Ars à un pèlerinage des évêques de France dans le cadre du 100ème anniversaire de la canonisation de saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars. La page d’Évangile du jour et les commentaires du prédicateur m’ont beaucoup touché. Je les ai alors reçus comme une grâce : le Seigneur est venu m’éclairer pour vous guider dans cette nouvelle étape de la vie diocésaine. Relisons :
La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.
COMMUNION
L’évangéliste nous permet de comprendre comment les collaborateurs de la pêche aux poissons deviennent des associés dont la mission est d’être des pêcheurs d’hommes. C’est le texte grec qui nous permet de saisir cette distinction, alors que la traduction liturgique ne va pas aussi loin : ces personnes sont d’abord des compagnons (metochoi) et deviennent des associés (koinonoi – noter que le nom féminin koinonia se traduit justement par communion). Autrement dit, la condition de réussite de la pêche ne résidepas dans le fait de savoir pêcher du poisson, mais dans le fait d’être en communion avec Pierre.
La communion de l’Église est sacramentelle, pour vivre le mystère de l’Église, Corps du Christ, plutôt que fonctionnelle, « pour faire des choses ». L’Église n’est pas la juxtaposition de personnes qui s’assoient les unes à côté des autres sur des bancs. Nous l’aimons comme une famille rassemblant tous les baptisés. Pour parler avec des images : une église n’est pas seulement faite de multiples petites chapelles dédiées à telle ou telle dévotion, mais celles-ci sont regroupées en un seul édifice autour d’une grande nef et d’un autel majeur. Autre image, l’équipe de rugby comporte les piliers, le talonneur, le demi de mêlée, le demi d’ouverture, les centres, les ailiers, l’arrière, et chacun est indispensable selon son gabarit. Dernière image, un orchestre n’offrira une riche et belle harmonie que si chaque instrument joue sa partition en symphonie avec les autres et avec le chef d’orchestre ; sinon la cacophonie est assurée.
Nous allons rechercher cette vraie communion en deux directions que j’identifie comme prioritaires depuis mon arrivée dans le diocèse :
• La communion entre tous les baptisés, et entre laïcs et clercs : à bord de la barque de l’Église, chacun a son rôle à jouer. Le magistère de Pierre et l’enseignement des pères conciliaires de Vatican II ne cessent de nous le rappeler. L’Église-communion est une grande famille dans laquelle tous partagent la même dignité baptismale et la même vocation à la sainteté. Qu’il soit fidèle laïc, consacré, diacre, prêtre, évêque, chacun avance sur son chemin personnel en réponse à l’appel du Seigneur, mais le but est le même pour tous : le salut en Jésus-Christ et la communion bienheureuse et éternelle en Dieu. Cette communion céleste se prépare et se vit déjà sur cette terre dans la vie de l’Église. A bord des deux barques, qu’on rame ou qu’on jette les filets, chacun s’y met. Il n’y a pas ceux qui font et ceux qui assistent. Tous participent, tous sont responsables. Le texte le dit bien en utilisant le pluriel : « Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre… Ils capturèrent une telle quantité de poisson ».
Un diocèse est une portion du peuple de Dieu. En son sein, on trouve toute la diversité des personnes, des sensibilités, des engagements, des façons de prier, des vocations. C’est l’Église, le Corps du Christ, bien autre chose que des « chapelles » séparées les unes des autres ou concurrentes les unes des autres. Le Seigneur nous rassemble dans cette harmonie de l’Église pour une symphonie missionnaire.
• Nous veillerons ensemble à réparer les filets déchirés, à cultiver la bienveillance, le respect mutuel entre tous les membres de l’Église diocésaine quels que soient leur sensibilité, leur âge, leur situation et leur lieu de vie…
La communion entre les prêtres et l’évêque, et entre prêtres : qu’il s’appelle Joseph, Dominique ou François, l’évêque n’est rien sans les prêtres et les prêtres ne sont rien sans l’évêque. Ensemble ils consti-tuent le presbyterium qui n’est pas une corporation mais une commu-nion sacramentelle regroupant des koinonoi (associés) actifs pour pêcher des hommes. Le prêtre ne gère pas sa petite affaire dans sa barque à lui et selon ses préférences. Il est envoyé « au large » par l’évêque au nom du Seigneur pour jeter les filets. Comme pour les apôtres autrefois, c’est une mission qui ne leur appartient pas et qui les dépasse.
Je suis admiratif devant le dévouement et l’ardeur missionnaire des 250 prêtres du diocèse. Je connais aussi et j’accompagne toutes les situations particulières de difficulté. Je constate les fécondes amitiés fraternelles et spirituelles. Je n’ignore pas les déceptions provoquées par des initiatives n’ayant pu aboutir. Je mesure les goûts d’indépendance et certains par-ticularismes. Nous sommes conscients des différents lieux de tension. L’évêque a pour mission de rassembler en un seul corps tous les prêtres, tel un père, un frère et un ami6, dans une véritable communion à la fois visible et tout intérieure, une fraternité sacramentelle.
. Je ferai prochainement des propositions concrètes aux prêtres pour consolider encore cette communion entre nous. Notre fraternité sera source de vocations, je le crois, pour les jeunes du Var encore trop peu présents dans notre séminaire de La Castille sur l’avenir duquel je veille avec soin.
Pour les deux aspects de la communion évoqués ci-dessus, la liturgie doit pouvoir nous aider, plutôt que de représenter un terrain de combat : «En effet, la liturgie, par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l’Eucharistie, s’exerce l’œuvre de notre rédemption, contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. »
Le missel (« de saint Paul VI ») publié en 1970 et révisé par saint Jean-Paul II en 2002 est la règle liturgique pour toute l’Église et donc aussi dans le Var. Le missel (« de saint Pie V ») d’avant le concile Vatican II bénéficie d’une concession d’utilisation : il faudra en examiner les contours dans notre diocèse.
Je souhaite que nous réfléchissions tous ensemble à ce qui pourra contribuer vraiment à la communion, dans le respect des normes liturgiques et du droit des fidèles. Des avancées sont certainement possibles, en relation avec le Saint-Siège.
MISSION
L’ordre de Jésus est clair : « Avance au large, et jetez les filets. » Monseigneur Madec en avait fait sa devise « In verbo tuo, laxabo rete » (« Sur ton ordre, je vais jeter les filets »), et saint Jean-Paul II nous avait envoyés en mission pour le troisième millénaire avec ce mot d’ordre « Duc in altum » (« Avance au large »), repris par Monseigneur Rey pour la démarche diocésaine en 2013.
Jésus demande donc à Pierre de jeter les filets. Pierre qui connaît son métier et possède parfaitement toutes les techniques de la pêche, affirme pourtant à Jésus que, avec ses collaborateurs, ils ont travaillé et « peiné toute la nuit sans rien prendre ». Mais Jésus est à bord de la barque désormais. On passe de la pêche ordinaire à la mission de l’Évangile. Le Maître vient de prêcher depuis la barque éloignée un peu du rivage, la surface de l’eau lui servant de sonorisation. Il demande maintenant d’aller au large, en eau profonde. Les apôtres apprennent à s’abandonner totalement à Lui et à lui faire confiance : « Sur ta parole, je vais jeter les filets ». Il leur faut prendre ce risque. Les filets seront débordants, tout près de craquer à cause de la quantité de poisson, et hissés difficilement à bord des deux barques. La pêche n’a été bonne que parce qu’elle était conduite par Jésus.
La mission est d’abord l’affaire du Seigneur avant d’être la nôtre. Nous ne sommes que ses serviteurs qui agissons, parfois avec bien des difficultés, mais surtout avec la grâce. Plus nous vivrons avec Jésus, plus nous laisserons la place à Jésus, et plus notre mission quittera la stérilité ou l’échec apparent. Si notre diocèse a souvent été présenté comme exemplaire sur le plan missionnaire, il est certain que nous devons poursuivre l’effort pour rapporter une « telle quantité de poisson ». Le Seigneur ne nous demande-t-il pas un renouvellement de notre engagement ? Pas d’abord avec des techniques de pêche décrites dans des manuels et qui réussiraient à tous les coups. Préférons une proximité avec Lui qui renouvelle toute chose.
Cette mission est très stimulante pour nous : autant quand il sort de l’eau qui est son milieu naturel, le poisson meurt ; autant quand il est pris par les filets apostoliques, l’homme entre dans la vie en échappant à la mort. Le bain du Baptême nous le rappelle : « Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Comme Pierre, chacun d’entre nous a déjà été repêché par Jésus, arraché à la puissance du mal et du péché, sauvé de la mort. C’est cette expérience spirituelle intense qui nous permet de nous donner totalement pour la mission aujourd’hui :
• En paroles et en actes : saint Paul VI disait lors de l’audience générale du 2 octobre 1974 : « L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins. Il éprouve en effet une répulsion instinctive pour tout ce qui peut apparaître mystification, façade, compromis. Dans un tel contexte, on comprend l’importance d’une vie qui résonne vraiment de l’Évangile ! » Il reprenait cette idée dans l’exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi le 8 décembre 1975 : « Croyez-vous vraiment à ce que vous annoncez ? Vivez-vous ce que vous croyez ? Prêchez-vous vraiment ce que vous vivez ? Plus que jamais le témoignage de la vie est devenu une condition essentielle de l’efficacité profonde de la prédication. »
Nous devons ensemble fuir les postures de principe et rechercher cette authenticité en rayonnant de la présence de Jésus. Ne pas faire semblant, ne pas faire la leçon : le Seigneur nous appelle à être des témoins qui font ce qu’ils disent, des lumières qui éclairent sans éblouir, des cœurs qui accueillent avec bienveillance et qui mettent en relation avec Jésus et pas seulement avec une institution.
Nous serons témoins non seulement par la parole mais aussi par les actes, tout particulièrement dans le cadre de la diaconie au service des plus fragiles, des personnes blessées et des victimes, et vivant un dialogue confiant et ouvert avec le monde.
La nouvelle évangélisation : cette mission, nous ne l’accomplissons pas pour le passé. Elle est devant nous. Les papes successifs depuis le concile Vatican II ont parlé de la « nouvelle évangélisation ». Je reprends ici encore la dynamique déjà insufflée dans notre diocèse : il s’agit d’annon- cer le même Évangile avec des moyens et un langage nouveaux. Notre mission ne consiste pas à restaurer un passé révolu mais à annoncer l’Évangile dans le monde qui est le nôtre aujourd’hui. Les apôtres avaient essayé avec leurs vieilles méthodes bien rôdées. C’est en jetant à nou- veau les filets qu’ils ont ramené cette quantité incroyable de poissons. Le pape Benoit XVI nous rappelait alors notre vocation à la sainteté : « Les saints sont les vrais protagonistes de l’évangélisation dans toutes ses expressions. Ils sont aussi, d’une manière particulière, les pionniers et les meneurs de la nouvelle évangélisation. »
À l’écoute de l’Esprit-Saint, n’ayons pas peur d’être des saints inventifs, tout en gardant la prudence et le discernement. Avec la force de l’Esprit, et riches de tous ceux qui ont été accueillis venant d’ailleurs, nous verrons comment envisager de nous appauvrir en envoyant en mission à l’extérieur du diocèse. Ce serait une source de fécondité.
Le Seigneur nous appelle à être ces saints joyeux et audacieux pour la mission. J’ai été frappé ces derniers mois par cette personne me disant : « C’est une paroisse d’environ soixante personnes », en fait les soixante personnes venant à la messe dominicale, comme si tous les autres habi-tants du quartier n’étaient pas les destinataires potentiels de l’annonce de l’Évangile. Tant les voisins que le pasteur sont appelés à vivre une vraie proximité et une fraternité simple, une charité bienveillante pour que l’Évangile passe à travers leur présence, leurs paroles, leur amitié. L’Année Sainte invite les « pèlerins d’espérance » à agir ainsi en trois grandes directions : la construction de la paix, la défense et la promotion de la vie, et la fraternité.
Afin de développer cet axe missionnaire, j’entreprendrai prochainement des visites pastorales pour mieux connaître les projets magnifiques déjà déployés, encourager ceux qui les mettent en œuvre et ouvrir de nouvelles voies, tant dans les paroisses que les établissements d’enseignement et les mouvements.
PARTICIPATION
Une communion missionnaire, c’est bien. Il reste à la bâtir ensemble. C’est peut-être là le point singulier que je souhaite apporter. Nous le voyons dans la page d’Évangile de la pêche miraculeuse. Une fois la barque éloignée du rivage et avancée au large, une fois les filets jetés à l’eau, une fois les filets ramenés pleins de poissons, « ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. »1 Seul, Pierre n’y serait pas arrivé. Et une seule barque n’aurait pas suffi pour y déverser tous les poissons. Il fallait s’y mettre à plusieurs, se faire confiance les uns les autres, apprendre à abandonner chacun sa présomption. Faire appel à l’autre barque n’a rien fait perdre à Pierre puisque sa barque s’enfonce avec tant de poissons, et que l’autre barque en a été aussi pourvue.
Les bienfaits de Dieu, les fruits de la mission se partagent avec allégresse, et personne n’en est propriétaire. Il n’y a rien à perdre en acceptant de ne pas être le centre du monde ni l’autorité suprême. La collaboration de Pierre avec les autres se retrouve dans la vie et l’activité missionnaire de l’Église : à tous les échelons, nous le savons bien, une saine collaboration, respectueuse de ce que chacun est, manifeste le fait que tous les baptisés sont responsables. Il n’y a pas ceux qui dirigent et ceux qui obéissent ; il y a les pasteurs qui conduisent le troupeau en prenant toujours le soin de discerner avec ceux qu’ils sont chargés de guider, en ayant à cœur de « sentir l’odeur du troupeau » comme l’a dit le pape François. Je souhaite mettre en œuvre cette coresponsabilité dans notre Église diocésaine :
• Ensemble : je ferai appel à vous pour une réflexion ouverte sur l’avenir de notre Église diocésaine. La forme reste à définir.
Plusieurs thématiques devront être abordées dans un climat d’écoute mutuelle et d’écoute du Saint-Esprit. Je pense en particulier aux thèmes suivants, sans exclure les autres : la pastorale des jeunes et des vocations qui nous préoccupe, la vie familiale qui nous touche tous avec sa fécondité et ses blessures, la vie liturgique dans laquelle nous enracinons notre vie chrétienne, le tissu paroissial dans lequel nous vivons notre foi et construisons l’Église.
L’évêque travaille avec ses différents conseils (épiscopal, économique, pastoral, presbytéral, vie consacrée, séminaire, etc). Il nous faudra déve-lopper ce mode de collaboration à tous les échelons. Il existe déjà dans les paroisses des conseils paroissiaux, des Équipes d’Animation Pasto- rale. C’est parfois une réalité encore embryonnaire ou un élément de décor. Mon expérience pastorale me montre que c’est non seulement indispensable, mais vraiment enrichissant pour chacun et pour l’Église. Cette lettre pastorale est d’ailleurs le fruit d’un travail mené avec le conseil épiscopal et le conseil d’animation pastorale (CAP) à partir de ma première rédaction.
Avec tous : bâtir, c’est un vaste chantier jamais terminé. Nous sommes les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Chacun est appelé à prendre sa part à la mission de l’Église, et à tenir sa place comme un instrument dans l’orchestre. Ainsi, nous deviendrons vrai-ment une communion missionnaire à bâtir ensemble.
Déjà une riche diversité existe dans notre diocèse. C’est notre « écosys- tème » varois. Plus que pour « boucher les trous », cette diversité permet à l’Église locale d’être véritablement l’Église catholique, faite de tant de talents reçus du Seigneur lui-même, et ouverte pour accueillir. C’est le cas pour ceux qui demandent le baptême, échappant à toute prévision et à nos plans pastoraux. Ils sont de plus en plus nombreux dans notre diocèse (174 adultes et 70 adolescents cette année) comme dans tous les diocèses de France. Il nous revient de les intégrer dans la construction de l’Église.
Comme chaque pierre d’un édifice apporte un élément de solidité ou d’ornementation, chaque « pierre vivante » de l’Église du Seigneur ap- porte une note de charité, de contemplation, d’ardeur missionnaire, d’enseignement, de service. Chacun a sa vocation personnelle à réali-ser ; tous ont la même vocation à devenir des saints.
Pour permettre cela, il nous faut déployer ensemble ces trois moteurs de la vie ecclésiale repris par le synode des évêques : communion – participation – mission. Ils ne disent pas autre chose que « une communion missionnaire à bâtir ensemble » ! Nous devrons mettre en œuvre le processus que le pape vient de nous indiquer le 15 mars par la secrétairerie générale du synode des évêques. Dans cette ligne, je forme le projet de rassembler régulièrement les équipes paroissiales (EAP) pour définir nos axes pastoraux et missionnaires.
Vous l’avez saisi, cette vision diocésaine que je fais mienne sans hésiter, nous guidera encore dans les mois et les années à venir. Il faudra la décliner en bien des domaines, rechercher ses modalités d’application dans les dimensions traditionnelles de la mission de l’Église : enseigner, sanctifier,servir.
Jetons l’ancre de l’espérance pour ne pas nous laisser partir à la dérive, pour ne pas nous décourager. J’invite chacun à prier chaque jour, comme il en fera le choix, pour que se lèvent dans nos communautés tous ceux qui donneront leur vie pour les animer et transmettre ce qui vient de Dieu. L’émergence de vocations locales sera un signe de notre vitalité missionnaire et un grand message d’espérance.
« Laissons-nous dès aujourd’hui attirer par l’espérance et faisons en sorte qu’elle devienne contagieuse à travers nous, pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire : ‘’Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur‘’ . Puisse la force de l’espérance remplir notre présent, dans l’attente confiante du retour du Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire, maintenant et pour les siècles à venir. »
Par l’intercession de sainte Marie-Madeleine, que Dieu bénisse l’Église de Fréjus-Toulon.
François Touvet
évêque de Fréjus-Toulon
à Toulon, le 13 avril 2025,
dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Publié le 18 avril 2025
Lettre Pastorale de Monseigneur François Touvet
Frères et sœurs du diocèse de Fréjus-Toulon,
Dans la bulle d’indiction du Jubilé « L’espérance ne déçoit pas », le pape François reprend à la Lettre aux Hébreux l’image évocatrice de l’ancre comme symbole de l’espérance :
« L’image de l’ancre évoque bien la stabilité et la sécurité que nous pos-sédons au milieu des eaux agitées de la vie si nous nous en remettons auSeigneur Jésus. Les tempêtes ne pourront jamais l’emporter parce que nous sommes ancrés dans l’espérance de la grâce qui est capable de nous faire vivre dans le Christ en triomphant du péché, de la peur et de la mort. Cette espérance, bien plus grande que les satisfactions quotidiennes et l’amélioration des conditions de vie, nous porte au-delà des épreuves et nous pousse à marcher sans perdre de vue la grandeur du but auquel nous sommes appelés, le Ciel. Le prochain Jubilé sera donc une Année Sainte caractérisée parl’espérance qui ne passe pas, l’espérance qui est en Dieu. »
Cette ancre figure dans le blason épiscopal que je porte depuis neuf ans, alors que j’étais ordonné évêque au cœur d’une Année Sainte de la miséricorde le 28 février 2016. Elle est gravée dans mon cœur. À peine le Jubilé ordinaire 2025 était-il ouvert que je recevais par succession la charge pastorale de notre Église diocésaine. J’accueille avec humilité et dans l’action de grâce ce signe du Seigneur au cœur d’une Année Sainte dont l’espérance est le fil conducteur. Je m’engage à exercer mon ministère en « pèlerin d’espérance » (thème du Jubilé 2025), d’autant qu’une tempête a secoué la barque du diocèse. Le Seigneur nous appelle à la confiance pour que les vents et la mer se calment. Et c’est aussi vrai plus largement : le contexte géopolitique actuel génère des angoisses et des violences. L’instabilité générale réclame ce sursaut d’espérance.
Comme je l’ai exprimé à l’issue de la messe d’action de grâce et d’adieu de Monseigneur Rey le 1er février à La Castille, je m’inscris dans la continuité parce que c’est la réalité de la succession apostolique. Parce que c’est aussi la réalité de l’humanité, je le fais et le ferai avec la nouveauté de ce que je suis, ma personnalité, mon histoire, ma formation, mon âge, mon expérience pastorale, et surtout avec vous tous. Passionné par la mission et l’évangélisation, je reprends volontiers la vision diocésaine : « Une communion missionnaire à bâtir ensemble ». Cette expression ne doit pas rester un slogan ou une formule magique. Nous devons chercher à la mettre en œuvre, vraiment. En cette Semaine Sainte où nous célébrons le cœur de la foi chrétienne, le mystère de notre salut par la mort et la résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ, je souhaite vous partager mes réflexions pastorales pour aujourd’hui et demain, ouvrir quelques chantiers à mener avec vous, et tracer la route pour l’avenir. Rassemblés bientôt pour le pèlerinage jubilaire diocésain le 1er mai prochain sur le tombeau de sainte Marie-Madeleine, « apôtre des apôtres » et patronne principale de notre diocèse, nous invoquerons le Saint-Esprit pour écrire ensemble les nouvelles pages de l’histoire sainte du Var.
En février dernier, j’ai eu la joie de participer à Ars à un pèlerinage des évêques de France dans le cadre du 100ème anniversaire de la canonisation de saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars. La page d’Évangile du jour et les commentaires du prédicateur m’ont beaucoup touché. Je les ai alors reçus comme une grâce : le Seigneur est venu m’éclairer pour vous guider dans cette nouvelle étape de la vie diocésaine. Relisons :
La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.
COMMUNION
L’évangéliste nous permet de comprendre comment les collaborateurs de la pêche aux poissons deviennent des associés dont la mission est d’être des pêcheurs d’hommes. C’est le texte grec qui nous permet de saisir cette distinction, alors que la traduction liturgique ne va pas aussi loin : ces personnes sont d’abord des compagnons (metochoi) et deviennent des associés (koinonoi – noter que le nom féminin koinonia se traduit justement par communion). Autrement dit, la condition de réussite de la pêche ne résidepas dans le fait de savoir pêcher du poisson, mais dans le fait d’être en communion avec Pierre.
La communion de l’Église est sacramentelle, pour vivre le mystère de l’Église, Corps du Christ, plutôt que fonctionnelle, « pour faire des choses ». L’Église n’est pas la juxtaposition de personnes qui s’assoient les unes à côté des autres sur des bancs. Nous l’aimons comme une famille rassemblant tous les baptisés. Pour parler avec des images : une église n’est pas seulement faite de multiples petites chapelles dédiées à telle ou telle dévotion, mais celles-ci sont regroupées en un seul édifice autour d’une grande nef et d’un autel majeur. Autre image, l’équipe de rugby comporte les piliers, le talonneur, le demi de mêlée, le demi d’ouverture, les centres, les ailiers, l’arrière, et chacun est indispensable selon son gabarit. Dernière image, un orchestre n’offrira une riche et belle harmonie que si chaque instrument joue sa partition en symphonie avec les autres et avec le chef d’orchestre ; sinon la cacophonie est assurée.
Nous allons rechercher cette vraie communion en deux directions que j’identifie comme prioritaires depuis mon arrivée dans le diocèse :
• La communion entre tous les baptisés, et entre laïcs et clercs : à bord de la barque de l’Église, chacun a son rôle à jouer. Le magistère de Pierre et l’enseignement des pères conciliaires de Vatican II ne cessent de nous le rappeler. L’Église-communion est une grande famille dans laquelle tous partagent la même dignité baptismale et la même vocation à la sainteté. Qu’il soit fidèle laïc, consacré, diacre, prêtre, évêque, chacun avance sur son chemin personnel en réponse à l’appel du Seigneur, mais le but est le même pour tous : le salut en Jésus-Christ et la communion bienheureuse et éternelle en Dieu. Cette communion céleste se prépare et se vit déjà sur cette terre dans la vie de l’Église. A bord des deux barques, qu’on rame ou qu’on jette les filets, chacun s’y met. Il n’y a pas ceux qui font et ceux qui assistent. Tous participent, tous sont responsables. Le texte le dit bien en utilisant le pluriel : « Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre… Ils capturèrent une telle quantité de poisson ».
Un diocèse est une portion du peuple de Dieu. En son sein, on trouve toute la diversité des personnes, des sensibilités, des engagements, des façons de prier, des vocations. C’est l’Église, le Corps du Christ, bien autre chose que des « chapelles » séparées les unes des autres ou concurrentes les unes des autres. Le Seigneur nous rassemble dans cette harmonie de l’Église pour une symphonie missionnaire.
• Nous veillerons ensemble à réparer les filets déchirés, à cultiver la bienveillance, le respect mutuel entre tous les membres de l’Église diocésaine quels que soient leur sensibilité, leur âge, leur situation et leur lieu de vie…
La communion entre les prêtres et l’évêque, et entre prêtres : qu’il s’appelle Joseph, Dominique ou François, l’évêque n’est rien sans les prêtres et les prêtres ne sont rien sans l’évêque. Ensemble ils consti-tuent le presbyterium qui n’est pas une corporation mais une commu-nion sacramentelle regroupant des koinonoi (associés) actifs pour pêcher des hommes. Le prêtre ne gère pas sa petite affaire dans sa barque à lui et selon ses préférences. Il est envoyé « au large » par l’évêque au nom du Seigneur pour jeter les filets. Comme pour les apôtres autrefois, c’est une mission qui ne leur appartient pas et qui les dépasse.
Je suis admiratif devant le dévouement et l’ardeur missionnaire des 250 prêtres du diocèse. Je connais aussi et j’accompagne toutes les situations particulières de difficulté. Je constate les fécondes amitiés fraternelles et spirituelles. Je n’ignore pas les déceptions provoquées par des initiatives n’ayant pu aboutir. Je mesure les goûts d’indépendance et certains par-ticularismes. Nous sommes conscients des différents lieux de tension. L’évêque a pour mission de rassembler en un seul corps tous les prêtres, tel un père, un frère et un ami6, dans une véritable communion à la fois visible et tout intérieure, une fraternité sacramentelle.
. Je ferai prochainement des propositions concrètes aux prêtres pour consolider encore cette communion entre nous. Notre fraternité sera source de vocations, je le crois, pour les jeunes du Var encore trop peu présents dans notre séminaire de La Castille sur l’avenir duquel je veille avec soin.
Pour les deux aspects de la communion évoqués ci-dessus, la liturgie doit pouvoir nous aider, plutôt que de représenter un terrain de combat : «En effet, la liturgie, par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l’Eucharistie, s’exerce l’œuvre de notre rédemption, contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. »
Le missel (« de saint Paul VI ») publié en 1970 et révisé par saint Jean-Paul II en 2002 est la règle liturgique pour toute l’Église et donc aussi dans le Var. Le missel (« de saint Pie V ») d’avant le concile Vatican II bénéficie d’une concession d’utilisation : il faudra en examiner les contours dans notre diocèse.
Je souhaite que nous réfléchissions tous ensemble à ce qui pourra contribuer vraiment à la communion, dans le respect des normes liturgiques et du droit des fidèles. Des avancées sont certainement possibles, en relation avec le Saint-Siège.
MISSION
L’ordre de Jésus est clair : « Avance au large, et jetez les filets. » Monseigneur Madec en avait fait sa devise « In verbo tuo, laxabo rete » (« Sur ton ordre, je vais jeter les filets »), et saint Jean-Paul II nous avait envoyés en mission pour le troisième millénaire avec ce mot d’ordre « Duc in altum » (« Avance au large »), repris par Monseigneur Rey pour la démarche diocésaine en 2013.
Jésus demande donc à Pierre de jeter les filets. Pierre qui connaît son métier et possède parfaitement toutes les techniques de la pêche, affirme pourtant à Jésus que, avec ses collaborateurs, ils ont travaillé et « peiné toute la nuit sans rien prendre ». Mais Jésus est à bord de la barque désormais. On passe de la pêche ordinaire à la mission de l’Évangile. Le Maître vient de prêcher depuis la barque éloignée un peu du rivage, la surface de l’eau lui servant de sonorisation. Il demande maintenant d’aller au large, en eau profonde. Les apôtres apprennent à s’abandonner totalement à Lui et à lui faire confiance : « Sur ta parole, je vais jeter les filets ». Il leur faut prendre ce risque. Les filets seront débordants, tout près de craquer à cause de la quantité de poisson, et hissés difficilement à bord des deux barques. La pêche n’a été bonne que parce qu’elle était conduite par Jésus.
La mission est d’abord l’affaire du Seigneur avant d’être la nôtre. Nous ne sommes que ses serviteurs qui agissons, parfois avec bien des difficultés, mais surtout avec la grâce. Plus nous vivrons avec Jésus, plus nous laisserons la place à Jésus, et plus notre mission quittera la stérilité ou l’échec apparent. Si notre diocèse a souvent été présenté comme exemplaire sur le plan missionnaire, il est certain que nous devons poursuivre l’effort pour rapporter une « telle quantité de poisson ». Le Seigneur ne nous demande-t-il pas un renouvellement de notre engagement ? Pas d’abord avec des techniques de pêche décrites dans des manuels et qui réussiraient à tous les coups. Préférons une proximité avec Lui qui renouvelle toute chose.
Cette mission est très stimulante pour nous : autant quand il sort de l’eau qui est son milieu naturel, le poisson meurt ; autant quand il est pris par les filets apostoliques, l’homme entre dans la vie en échappant à la mort. Le bain du Baptême nous le rappelle : « Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Comme Pierre, chacun d’entre nous a déjà été repêché par Jésus, arraché à la puissance du mal et du péché, sauvé de la mort. C’est cette expérience spirituelle intense qui nous permet de nous donner totalement pour la mission aujourd’hui :
• En paroles et en actes : saint Paul VI disait lors de l’audience générale du 2 octobre 1974 : « L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins. Il éprouve en effet une répulsion instinctive pour tout ce qui peut apparaître mystification, façade, compromis. Dans un tel contexte, on comprend l’importance d’une vie qui résonne vraiment de l’Évangile ! » Il reprenait cette idée dans l’exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi le 8 décembre 1975 : « Croyez-vous vraiment à ce que vous annoncez ? Vivez-vous ce que vous croyez ? Prêchez-vous vraiment ce que vous vivez ? Plus que jamais le témoignage de la vie est devenu une condition essentielle de l’efficacité profonde de la prédication. »
Nous devons ensemble fuir les postures de principe et rechercher cette authenticité en rayonnant de la présence de Jésus. Ne pas faire semblant, ne pas faire la leçon : le Seigneur nous appelle à être des témoins qui font ce qu’ils disent, des lumières qui éclairent sans éblouir, des cœurs qui accueillent avec bienveillance et qui mettent en relation avec Jésus et pas seulement avec une institution.
Nous serons témoins non seulement par la parole mais aussi par les actes, tout particulièrement dans le cadre de la diaconie au service des plus fragiles, des personnes blessées et des victimes, et vivant un dialogue confiant et ouvert avec le monde.
La nouvelle évangélisation : cette mission, nous ne l’accomplissons pas pour le passé. Elle est devant nous. Les papes successifs depuis le concile Vatican II ont parlé de la « nouvelle évangélisation ». Je reprends ici encore la dynamique déjà insufflée dans notre diocèse : il s’agit d’annon- cer le même Évangile avec des moyens et un langage nouveaux. Notre mission ne consiste pas à restaurer un passé révolu mais à annoncer l’Évangile dans le monde qui est le nôtre aujourd’hui. Les apôtres avaient essayé avec leurs vieilles méthodes bien rôdées. C’est en jetant à nou- veau les filets qu’ils ont ramené cette quantité incroyable de poissons. Le pape Benoit XVI nous rappelait alors notre vocation à la sainteté : « Les saints sont les vrais protagonistes de l’évangélisation dans toutes ses expressions. Ils sont aussi, d’une manière particulière, les pionniers et les meneurs de la nouvelle évangélisation. »
À l’écoute de l’Esprit-Saint, n’ayons pas peur d’être des saints inventifs, tout en gardant la prudence et le discernement. Avec la force de l’Esprit, et riches de tous ceux qui ont été accueillis venant d’ailleurs, nous verrons comment envisager de nous appauvrir en envoyant en mission à l’extérieur du diocèse. Ce serait une source de fécondité.
Le Seigneur nous appelle à être ces saints joyeux et audacieux pour la mission. J’ai été frappé ces derniers mois par cette personne me disant : « C’est une paroisse d’environ soixante personnes », en fait les soixante personnes venant à la messe dominicale, comme si tous les autres habi-tants du quartier n’étaient pas les destinataires potentiels de l’annonce de l’Évangile. Tant les voisins que le pasteur sont appelés à vivre une vraie proximité et une fraternité simple, une charité bienveillante pour que l’Évangile passe à travers leur présence, leurs paroles, leur amitié. L’Année Sainte invite les « pèlerins d’espérance » à agir ainsi en trois grandes directions : la construction de la paix, la défense et la promotion de la vie, et la fraternité.
Afin de développer cet axe missionnaire, j’entreprendrai prochainement des visites pastorales pour mieux connaître les projets magnifiques déjà déployés, encourager ceux qui les mettent en œuvre et ouvrir de nouvelles voies, tant dans les paroisses que les établissements d’enseignement et les mouvements.
PARTICIPATION
Une communion missionnaire, c’est bien. Il reste à la bâtir ensemble. C’est peut-être là le point singulier que je souhaite apporter. Nous le voyons dans la page d’Évangile de la pêche miraculeuse. Une fois la barque éloignée du rivage et avancée au large, une fois les filets jetés à l’eau, une fois les filets ramenés pleins de poissons, « ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. »1 Seul, Pierre n’y serait pas arrivé. Et une seule barque n’aurait pas suffi pour y déverser tous les poissons. Il fallait s’y mettre à plusieurs, se faire confiance les uns les autres, apprendre à abandonner chacun sa présomption. Faire appel à l’autre barque n’a rien fait perdre à Pierre puisque sa barque s’enfonce avec tant de poissons, et que l’autre barque en a été aussi pourvue.
Les bienfaits de Dieu, les fruits de la mission se partagent avec allégresse, et personne n’en est propriétaire. Il n’y a rien à perdre en acceptant de ne pas être le centre du monde ni l’autorité suprême. La collaboration de Pierre avec les autres se retrouve dans la vie et l’activité missionnaire de l’Église : à tous les échelons, nous le savons bien, une saine collaboration, respectueuse de ce que chacun est, manifeste le fait que tous les baptisés sont responsables. Il n’y a pas ceux qui dirigent et ceux qui obéissent ; il y a les pasteurs qui conduisent le troupeau en prenant toujours le soin de discerner avec ceux qu’ils sont chargés de guider, en ayant à cœur de « sentir l’odeur du troupeau » comme l’a dit le pape François. Je souhaite mettre en œuvre cette coresponsabilité dans notre Église diocésaine :
• Ensemble : je ferai appel à vous pour une réflexion ouverte sur l’avenir de notre Église diocésaine. La forme reste à définir.
Plusieurs thématiques devront être abordées dans un climat d’écoute mutuelle et d’écoute du Saint-Esprit. Je pense en particulier aux thèmes suivants, sans exclure les autres : la pastorale des jeunes et des vocations qui nous préoccupe, la vie familiale qui nous touche tous avec sa fécondité et ses blessures, la vie liturgique dans laquelle nous enracinons notre vie chrétienne, le tissu paroissial dans lequel nous vivons notre foi et construisons l’Église.
L’évêque travaille avec ses différents conseils (épiscopal, économique, pastoral, presbytéral, vie consacrée, séminaire, etc). Il nous faudra déve-lopper ce mode de collaboration à tous les échelons. Il existe déjà dans les paroisses des conseils paroissiaux, des Équipes d’Animation Pasto- rale. C’est parfois une réalité encore embryonnaire ou un élément de décor. Mon expérience pastorale me montre que c’est non seulement indispensable, mais vraiment enrichissant pour chacun et pour l’Église. Cette lettre pastorale est d’ailleurs le fruit d’un travail mené avec le conseil épiscopal et le conseil d’animation pastorale (CAP) à partir de ma première rédaction.
Avec tous : bâtir, c’est un vaste chantier jamais terminé. Nous sommes les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Chacun est appelé à prendre sa part à la mission de l’Église, et à tenir sa place comme un instrument dans l’orchestre. Ainsi, nous deviendrons vrai-ment une communion missionnaire à bâtir ensemble.
Déjà une riche diversité existe dans notre diocèse. C’est notre « écosys- tème » varois. Plus que pour « boucher les trous », cette diversité permet à l’Église locale d’être véritablement l’Église catholique, faite de tant de talents reçus du Seigneur lui-même, et ouverte pour accueillir. C’est le cas pour ceux qui demandent le baptême, échappant à toute prévision et à nos plans pastoraux. Ils sont de plus en plus nombreux dans notre diocèse (174 adultes et 70 adolescents cette année) comme dans tous les diocèses de France. Il nous revient de les intégrer dans la construction de l’Église.
Comme chaque pierre d’un édifice apporte un élément de solidité ou d’ornementation, chaque « pierre vivante » de l’Église du Seigneur ap- porte une note de charité, de contemplation, d’ardeur missionnaire, d’enseignement, de service. Chacun a sa vocation personnelle à réali-ser ; tous ont la même vocation à devenir des saints.
Pour permettre cela, il nous faut déployer ensemble ces trois moteurs de la vie ecclésiale repris par le synode des évêques : communion – participation – mission. Ils ne disent pas autre chose que « une communion missionnaire à bâtir ensemble » ! Nous devrons mettre en œuvre le processus que le pape vient de nous indiquer le 15 mars par la secrétairerie générale du synode des évêques. Dans cette ligne, je forme le projet de rassembler régulièrement les équipes paroissiales (EAP) pour définir nos axes pastoraux et missionnaires.
Vous l’avez saisi, cette vision diocésaine que je fais mienne sans hésiter, nous guidera encore dans les mois et les années à venir. Il faudra la décliner en bien des domaines, rechercher ses modalités d’application dans les dimensions traditionnelles de la mission de l’Église : enseigner, sanctifier,servir.
Jetons l’ancre de l’espérance pour ne pas nous laisser partir à la dérive, pour ne pas nous décourager. J’invite chacun à prier chaque jour, comme il en fera le choix, pour que se lèvent dans nos communautés tous ceux qui donneront leur vie pour les animer et transmettre ce qui vient de Dieu. L’émergence de vocations locales sera un signe de notre vitalité missionnaire et un grand message d’espérance.
« Laissons-nous dès aujourd’hui attirer par l’espérance et faisons en sorte qu’elle devienne contagieuse à travers nous, pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire : ‘’Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur‘’ . Puisse la force de l’espérance remplir notre présent, dans l’attente confiante du retour du Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire, maintenant et pour les siècles à venir. »
Par l’intercession de sainte Marie-Madeleine, que Dieu bénisse l’Église de Fréjus-Toulon.
François Touvet
évêque de Fréjus-Toulon
à Toulon, le 13 avril 2025,
dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Publié le 18 avril 2025
Lettre Pastorale de Monseigneur François Touvet

Frères et sœurs du diocèse de Fréjus-Toulon,
Dans la bulle d’indiction du Jubilé « L’espérance ne déçoit pas », le pape François reprend à la Lettre aux Hébreux l’image évocatrice de l’ancre comme symbole de l’espérance :
« L’image de l’ancre évoque bien la stabilité et la sécurité que nous pos-sédons au milieu des eaux agitées de la vie si nous nous en remettons auSeigneur Jésus. Les tempêtes ne pourront jamais l’emporter parce que nous sommes ancrés dans l’espérance de la grâce qui est capable de nous faire vivre dans le Christ en triomphant du péché, de la peur et de la mort. Cette espérance, bien plus grande que les satisfactions quotidiennes et l’amélioration des conditions de vie, nous porte au-delà des épreuves et nous pousse à marcher sans perdre de vue la grandeur du but auquel nous sommes appelés, le Ciel. Le prochain Jubilé sera donc une Année Sainte caractérisée parl’espérance qui ne passe pas, l’espérance qui est en Dieu. »
Cette ancre figure dans le blason épiscopal que je porte depuis neuf ans, alors que j’étais ordonné évêque au cœur d’une Année Sainte de la miséricorde le 28 février 2016. Elle est gravée dans mon cœur. À peine le Jubilé ordinaire 2025 était-il ouvert que je recevais par succession la charge pastorale de notre Église diocésaine. J’accueille avec humilité et dans l’action de grâce ce signe du Seigneur au cœur d’une Année Sainte dont l’espérance est le fil conducteur. Je m’engage à exercer mon ministère en « pèlerin d’espérance » (thème du Jubilé 2025), d’autant qu’une tempête a secoué la barque du diocèse. Le Seigneur nous appelle à la confiance pour que les vents et la mer se calment. Et c’est aussi vrai plus largement : le contexte géopolitique actuel génère des angoisses et des violences. L’instabilité générale réclame ce sursaut d’espérance.
Comme je l’ai exprimé à l’issue de la messe d’action de grâce et d’adieu de Monseigneur Rey le 1er février à La Castille, je m’inscris dans la continuité parce que c’est la réalité de la succession apostolique. Parce que c’est aussi la réalité de l’humanité, je le fais et le ferai avec la nouveauté de ce que je suis, ma personnalité, mon histoire, ma formation, mon âge, mon expérience pastorale, et surtout avec vous tous. Passionné par la mission et l’évangélisation, je reprends volontiers la vision diocésaine : « Une communion missionnaire à bâtir ensemble ». Cette expression ne doit pas rester un slogan ou une formule magique. Nous devons chercher à la mettre en œuvre, vraiment. En cette Semaine Sainte où nous célébrons le cœur de la foi chrétienne, le mystère de notre salut par la mort et la résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ, je souhaite vous partager mes réflexions pastorales pour aujourd’hui et demain, ouvrir quelques chantiers à mener avec vous, et tracer la route pour l’avenir. Rassemblés bientôt pour le pèlerinage jubilaire diocésain le 1er mai prochain sur le tombeau de sainte Marie-Madeleine, « apôtre des apôtres » et patronne principale de notre diocèse, nous invoquerons le Saint-Esprit pour écrire ensemble les nouvelles pages de l’histoire sainte du Var.
En février dernier, j’ai eu la joie de participer à Ars à un pèlerinage des évêques de France dans le cadre du 100ème anniversaire de la canonisation de saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars. La page d’Évangile du jour et les commentaires du prédicateur m’ont beaucoup touché. Je les ai alors reçus comme une grâce : le Seigneur est venu m’éclairer pour vous guider dans cette nouvelle étape de la vie diocésaine. Relisons :
La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.
COMMUNION
L’évangéliste nous permet de comprendre comment les collaborateurs de la pêche aux poissons deviennent des associés dont la mission est d’être des pêcheurs d’hommes. C’est le texte grec qui nous permet de saisir cette distinction, alors que la traduction liturgique ne va pas aussi loin : ces personnes sont d’abord des compagnons (metochoi) et deviennent des associés (koinonoi – noter que le nom féminin koinonia se traduit justement par communion). Autrement dit, la condition de réussite de la pêche ne résidepas dans le fait de savoir pêcher du poisson, mais dans le fait d’être en communion avec Pierre.
La communion de l’Église est sacramentelle, pour vivre le mystère de l’Église, Corps du Christ, plutôt que fonctionnelle, « pour faire des choses ». L’Église n’est pas la juxtaposition de personnes qui s’assoient les unes à côté des autres sur des bancs. Nous l’aimons comme une famille rassemblant tous les baptisés. Pour parler avec des images : une église n’est pas seulement faite de multiples petites chapelles dédiées à telle ou telle dévotion, mais celles-ci sont regroupées en un seul édifice autour d’une grande nef et d’un autel majeur. Autre image, l’équipe de rugby comporte les piliers, le talonneur, le demi de mêlée, le demi d’ouverture, les centres, les ailiers, l’arrière, et chacun est indispensable selon son gabarit. Dernière image, un orchestre n’offrira une riche et belle harmonie que si chaque instrument joue sa partition en symphonie avec les autres et avec le chef d’orchestre ; sinon la cacophonie est assurée.
Nous allons rechercher cette vraie communion en deux directions que j’identifie comme prioritaires depuis mon arrivée dans le diocèse :
• La communion entre tous les baptisés, et entre laïcs et clercs : à bord de la barque de l’Église, chacun a son rôle à jouer. Le magistère de Pierre et l’enseignement des pères conciliaires de Vatican II ne cessent de nous le rappeler. L’Église-communion est une grande famille dans laquelle tous partagent la même dignité baptismale et la même vocation à la sainteté. Qu’il soit fidèle laïc, consacré, diacre, prêtre, évêque, chacun avance sur son chemin personnel en réponse à l’appel du Seigneur, mais le but est le même pour tous : le salut en Jésus-Christ et la communion bienheureuse et éternelle en Dieu. Cette communion céleste se prépare et se vit déjà sur cette terre dans la vie de l’Église. A bord des deux barques, qu’on rame ou qu’on jette les filets, chacun s’y met. Il n’y a pas ceux qui font et ceux qui assistent. Tous participent, tous sont responsables. Le texte le dit bien en utilisant le pluriel : « Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre… Ils capturèrent une telle quantité de poisson ».
Un diocèse est une portion du peuple de Dieu. En son sein, on trouve toute la diversité des personnes, des sensibilités, des engagements, des façons de prier, des vocations. C’est l’Église, le Corps du Christ, bien autre chose que des « chapelles » séparées les unes des autres ou concurrentes les unes des autres. Le Seigneur nous rassemble dans cette harmonie de l’Église pour une symphonie missionnaire.
• Nous veillerons ensemble à réparer les filets déchirés, à cultiver la bienveillance, le respect mutuel entre tous les membres de l’Église diocésaine quels que soient leur sensibilité, leur âge, leur situation et leur lieu de vie…
La communion entre les prêtres et l’évêque, et entre prêtres : qu’il s’appelle Joseph, Dominique ou François, l’évêque n’est rien sans les prêtres et les prêtres ne sont rien sans l’évêque. Ensemble ils consti-tuent le presbyterium qui n’est pas une corporation mais une commu-nion sacramentelle regroupant des koinonoi (associés) actifs pour pêcher des hommes. Le prêtre ne gère pas sa petite affaire dans sa barque à lui et selon ses préférences. Il est envoyé « au large » par l’évêque au nom du Seigneur pour jeter les filets. Comme pour les apôtres autrefois, c’est une mission qui ne leur appartient pas et qui les dépasse.
Je suis admiratif devant le dévouement et l’ardeur missionnaire des 250 prêtres du diocèse. Je connais aussi et j’accompagne toutes les situations particulières de difficulté. Je constate les fécondes amitiés fraternelles et spirituelles. Je n’ignore pas les déceptions provoquées par des initiatives n’ayant pu aboutir. Je mesure les goûts d’indépendance et certains par-ticularismes. Nous sommes conscients des différents lieux de tension. L’évêque a pour mission de rassembler en un seul corps tous les prêtres, tel un père, un frère et un ami6, dans une véritable communion à la fois visible et tout intérieure, une fraternité sacramentelle.
. Je ferai prochainement des propositions concrètes aux prêtres pour consolider encore cette communion entre nous. Notre fraternité sera source de vocations, je le crois, pour les jeunes du Var encore trop peu présents dans notre séminaire de La Castille sur l’avenir duquel je veille avec soin.
Pour les deux aspects de la communion évoqués ci-dessus, la liturgie doit pouvoir nous aider, plutôt que de représenter un terrain de combat : «En effet, la liturgie, par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l’Eucharistie, s’exerce l’œuvre de notre rédemption, contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. »
Le missel (« de saint Paul VI ») publié en 1970 et révisé par saint Jean-Paul II en 2002 est la règle liturgique pour toute l’Église et donc aussi dans le Var. Le missel (« de saint Pie V ») d’avant le concile Vatican II bénéficie d’une concession d’utilisation : il faudra en examiner les contours dans notre diocèse.
Je souhaite que nous réfléchissions tous ensemble à ce qui pourra contribuer vraiment à la communion, dans le respect des normes liturgiques et du droit des fidèles. Des avancées sont certainement possibles, en relation avec le Saint-Siège.
MISSION
L’ordre de Jésus est clair : « Avance au large, et jetez les filets. » Monseigneur Madec en avait fait sa devise « In verbo tuo, laxabo rete » (« Sur ton ordre, je vais jeter les filets »), et saint Jean-Paul II nous avait envoyés en mission pour le troisième millénaire avec ce mot d’ordre « Duc in altum » (« Avance au large »), repris par Monseigneur Rey pour la démarche diocésaine en 2013.
Jésus demande donc à Pierre de jeter les filets. Pierre qui connaît son métier et possède parfaitement toutes les techniques de la pêche, affirme pourtant à Jésus que, avec ses collaborateurs, ils ont travaillé et « peiné toute la nuit sans rien prendre ». Mais Jésus est à bord de la barque désormais. On passe de la pêche ordinaire à la mission de l’Évangile. Le Maître vient de prêcher depuis la barque éloignée un peu du rivage, la surface de l’eau lui servant de sonorisation. Il demande maintenant d’aller au large, en eau profonde. Les apôtres apprennent à s’abandonner totalement à Lui et à lui faire confiance : « Sur ta parole, je vais jeter les filets ». Il leur faut prendre ce risque. Les filets seront débordants, tout près de craquer à cause de la quantité de poisson, et hissés difficilement à bord des deux barques. La pêche n’a été bonne que parce qu’elle était conduite par Jésus.
La mission est d’abord l’affaire du Seigneur avant d’être la nôtre. Nous ne sommes que ses serviteurs qui agissons, parfois avec bien des difficultés, mais surtout avec la grâce. Plus nous vivrons avec Jésus, plus nous laisserons la place à Jésus, et plus notre mission quittera la stérilité ou l’échec apparent. Si notre diocèse a souvent été présenté comme exemplaire sur le plan missionnaire, il est certain que nous devons poursuivre l’effort pour rapporter une « telle quantité de poisson ». Le Seigneur ne nous demande-t-il pas un renouvellement de notre engagement ? Pas d’abord avec des techniques de pêche décrites dans des manuels et qui réussiraient à tous les coups. Préférons une proximité avec Lui qui renouvelle toute chose.
Cette mission est très stimulante pour nous : autant quand il sort de l’eau qui est son milieu naturel, le poisson meurt ; autant quand il est pris par les filets apostoliques, l’homme entre dans la vie en échappant à la mort. Le bain du Baptême nous le rappelle : « Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Comme Pierre, chacun d’entre nous a déjà été repêché par Jésus, arraché à la puissance du mal et du péché, sauvé de la mort. C’est cette expérience spirituelle intense qui nous permet de nous donner totalement pour la mission aujourd’hui :
• En paroles et en actes : saint Paul VI disait lors de l’audience générale du 2 octobre 1974 : « L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins. Il éprouve en effet une répulsion instinctive pour tout ce qui peut apparaître mystification, façade, compromis. Dans un tel contexte, on comprend l’importance d’une vie qui résonne vraiment de l’Évangile ! » Il reprenait cette idée dans l’exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi le 8 décembre 1975 : « Croyez-vous vraiment à ce que vous annoncez ? Vivez-vous ce que vous croyez ? Prêchez-vous vraiment ce que vous vivez ? Plus que jamais le témoignage de la vie est devenu une condition essentielle de l’efficacité profonde de la prédication. »
Nous devons ensemble fuir les postures de principe et rechercher cette authenticité en rayonnant de la présence de Jésus. Ne pas faire semblant, ne pas faire la leçon : le Seigneur nous appelle à être des témoins qui font ce qu’ils disent, des lumières qui éclairent sans éblouir, des cœurs qui accueillent avec bienveillance et qui mettent en relation avec Jésus et pas seulement avec une institution.
Nous serons témoins non seulement par la parole mais aussi par les actes, tout particulièrement dans le cadre de la diaconie au service des plus fragiles, des personnes blessées et des victimes, et vivant un dialogue confiant et ouvert avec le monde.
La nouvelle évangélisation : cette mission, nous ne l’accomplissons pas pour le passé. Elle est devant nous. Les papes successifs depuis le concile Vatican II ont parlé de la « nouvelle évangélisation ». Je reprends ici encore la dynamique déjà insufflée dans notre diocèse : il s’agit d’annon- cer le même Évangile avec des moyens et un langage nouveaux. Notre mission ne consiste pas à restaurer un passé révolu mais à annoncer l’Évangile dans le monde qui est le nôtre aujourd’hui. Les apôtres avaient essayé avec leurs vieilles méthodes bien rôdées. C’est en jetant à nou- veau les filets qu’ils ont ramené cette quantité incroyable de poissons. Le pape Benoit XVI nous rappelait alors notre vocation à la sainteté : « Les saints sont les vrais protagonistes de l’évangélisation dans toutes ses expressions. Ils sont aussi, d’une manière particulière, les pionniers et les meneurs de la nouvelle évangélisation. »
À l’écoute de l’Esprit-Saint, n’ayons pas peur d’être des saints inventifs, tout en gardant la prudence et le discernement. Avec la force de l’Esprit, et riches de tous ceux qui ont été accueillis venant d’ailleurs, nous verrons comment envisager de nous appauvrir en envoyant en mission à l’extérieur du diocèse. Ce serait une source de fécondité.
Le Seigneur nous appelle à être ces saints joyeux et audacieux pour la mission. J’ai été frappé ces derniers mois par cette personne me disant : « C’est une paroisse d’environ soixante personnes », en fait les soixante personnes venant à la messe dominicale, comme si tous les autres habi-tants du quartier n’étaient pas les destinataires potentiels de l’annonce de l’Évangile. Tant les voisins que le pasteur sont appelés à vivre une vraie proximité et une fraternité simple, une charité bienveillante pour que l’Évangile passe à travers leur présence, leurs paroles, leur amitié. L’Année Sainte invite les « pèlerins d’espérance » à agir ainsi en trois grandes directions : la construction de la paix, la défense et la promotion de la vie, et la fraternité.
Afin de développer cet axe missionnaire, j’entreprendrai prochainement des visites pastorales pour mieux connaître les projets magnifiques déjà déployés, encourager ceux qui les mettent en œuvre et ouvrir de nouvelles voies, tant dans les paroisses que les établissements d’enseignement et les mouvements.
PARTICIPATION
Une communion missionnaire, c’est bien. Il reste à la bâtir ensemble. C’est peut-être là le point singulier que je souhaite apporter. Nous le voyons dans la page d’Évangile de la pêche miraculeuse. Une fois la barque éloignée du rivage et avancée au large, une fois les filets jetés à l’eau, une fois les filets ramenés pleins de poissons, « ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. »1 Seul, Pierre n’y serait pas arrivé. Et une seule barque n’aurait pas suffi pour y déverser tous les poissons. Il fallait s’y mettre à plusieurs, se faire confiance les uns les autres, apprendre à abandonner chacun sa présomption. Faire appel à l’autre barque n’a rien fait perdre à Pierre puisque sa barque s’enfonce avec tant de poissons, et que l’autre barque en a été aussi pourvue.
Les bienfaits de Dieu, les fruits de la mission se partagent avec allégresse, et personne n’en est propriétaire. Il n’y a rien à perdre en acceptant de ne pas être le centre du monde ni l’autorité suprême. La collaboration de Pierre avec les autres se retrouve dans la vie et l’activité missionnaire de l’Église : à tous les échelons, nous le savons bien, une saine collaboration, respectueuse de ce que chacun est, manifeste le fait que tous les baptisés sont responsables. Il n’y a pas ceux qui dirigent et ceux qui obéissent ; il y a les pasteurs qui conduisent le troupeau en prenant toujours le soin de discerner avec ceux qu’ils sont chargés de guider, en ayant à cœur de « sentir l’odeur du troupeau » comme l’a dit le pape François. Je souhaite mettre en œuvre cette coresponsabilité dans notre Église diocésaine :
• Ensemble : je ferai appel à vous pour une réflexion ouverte sur l’avenir de notre Église diocésaine. La forme reste à définir.
Plusieurs thématiques devront être abordées dans un climat d’écoute mutuelle et d’écoute du Saint-Esprit. Je pense en particulier aux thèmes suivants, sans exclure les autres : la pastorale des jeunes et des vocations qui nous préoccupe, la vie familiale qui nous touche tous avec sa fécondité et ses blessures, la vie liturgique dans laquelle nous enracinons notre vie chrétienne, le tissu paroissial dans lequel nous vivons notre foi et construisons l’Église.
L’évêque travaille avec ses différents conseils (épiscopal, économique, pastoral, presbytéral, vie consacrée, séminaire, etc). Il nous faudra déve-lopper ce mode de collaboration à tous les échelons. Il existe déjà dans les paroisses des conseils paroissiaux, des Équipes d’Animation Pasto- rale. C’est parfois une réalité encore embryonnaire ou un élément de décor. Mon expérience pastorale me montre que c’est non seulement indispensable, mais vraiment enrichissant pour chacun et pour l’Église. Cette lettre pastorale est d’ailleurs le fruit d’un travail mené avec le conseil épiscopal et le conseil d’animation pastorale (CAP) à partir de ma première rédaction.
Avec tous : bâtir, c’est un vaste chantier jamais terminé. Nous sommes les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Chacun est appelé à prendre sa part à la mission de l’Église, et à tenir sa place comme un instrument dans l’orchestre. Ainsi, nous deviendrons vrai-ment une communion missionnaire à bâtir ensemble.
Déjà une riche diversité existe dans notre diocèse. C’est notre « écosys- tème » varois. Plus que pour « boucher les trous », cette diversité permet à l’Église locale d’être véritablement l’Église catholique, faite de tant de talents reçus du Seigneur lui-même, et ouverte pour accueillir. C’est le cas pour ceux qui demandent le baptême, échappant à toute prévision et à nos plans pastoraux. Ils sont de plus en plus nombreux dans notre diocèse (174 adultes et 70 adolescents cette année) comme dans tous les diocèses de France. Il nous revient de les intégrer dans la construction de l’Église.
Comme chaque pierre d’un édifice apporte un élément de solidité ou d’ornementation, chaque « pierre vivante » de l’Église du Seigneur ap- porte une note de charité, de contemplation, d’ardeur missionnaire, d’enseignement, de service. Chacun a sa vocation personnelle à réali-ser ; tous ont la même vocation à devenir des saints.
Pour permettre cela, il nous faut déployer ensemble ces trois moteurs de la vie ecclésiale repris par le synode des évêques : communion – participation – mission. Ils ne disent pas autre chose que « une communion missionnaire à bâtir ensemble » ! Nous devrons mettre en œuvre le processus que le pape vient de nous indiquer le 15 mars par la secrétairerie générale du synode des évêques. Dans cette ligne, je forme le projet de rassembler régulièrement les équipes paroissiales (EAP) pour définir nos axes pastoraux et missionnaires.
Vous l’avez saisi, cette vision diocésaine que je fais mienne sans hésiter, nous guidera encore dans les mois et les années à venir. Il faudra la décliner en bien des domaines, rechercher ses modalités d’application dans les dimensions traditionnelles de la mission de l’Église : enseigner, sanctifier,servir.
Jetons l’ancre de l’espérance pour ne pas nous laisser partir à la dérive, pour ne pas nous décourager. J’invite chacun à prier chaque jour, comme il en fera le choix, pour que se lèvent dans nos communautés tous ceux qui donneront leur vie pour les animer et transmettre ce qui vient de Dieu. L’émergence de vocations locales sera un signe de notre vitalité missionnaire et un grand message d’espérance.
« Laissons-nous dès aujourd’hui attirer par l’espérance et faisons en sorte qu’elle devienne contagieuse à travers nous, pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire : ‘’Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur‘’ . Puisse la force de l’espérance remplir notre présent, dans l’attente confiante du retour du Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire, maintenant et pour les siècles à venir. »
Par l’intercession de sainte Marie-Madeleine, que Dieu bénisse l’Église de Fréjus-Toulon.
François Touvet
évêque de Fréjus-Toulon
à Toulon, le 13 avril 2025,
dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Dans ce dossier
Publié le 18 avril 2025