Le Pape Léon Premier

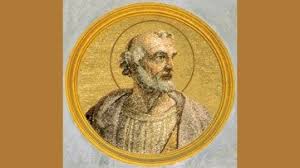
Tout commence à Constantinople, à la fin de l’année 448. Un moine influent, Eutychès, est convoqué par le patriarche Flavien. Le septuagénaire dirige un monastère respecté, près de la capitale de l’Empire romain d’Orient, mais son enseignement trouble : il affirme qu’il n’existe dans le Christ qu’une seule nature – divine – après l’Incarnation. Son raisonnement est simple : la divinité a absorbé l’humanité, comme la mer absorbe une goutte d’eau. La foi de Nicée, pour lui, est trop humaine.
Flavien le condamne. Le moine est déchu. Mais Eutychès ne s’avoue pas vaincu. Il fait appel à l’empereur Théodose II, dont il a les faveurs. Et surtout, il tente un geste inédit : il envoie un mémoire à Rome, demandant au pape de trancher. L’affaire bascule.
À Rome, le pape Léon, plus tard dit le Grand, comprend que ce débat ne relève pas seulement de la discipline. C’est toute la foi dans le mystère du Christ qui est en jeu. Le Verbe s’est-il vraiment fait chair ? Le salut est-il possible si le Christ n’a pas réellement partagé notre nature humaine ? L’évêque de Rome répond.
La lettre qu’il adresse au patriarche Flavien en juin 449 – le Tome à Flavien – est à la fois une réponse, un manifeste et un acte de gouvernement. Léon y soutient Flavien, mais il précise surtout la foi de l’Église : « Nous croyons que le Fils de Dieu est né de la Vierge Marie selon la chair, qu’il est vrai Dieu et vrai homme, parfait dans sa divinité, parfait dans son humanité », écrit Léon.
Il développe : le Christ n’est pas un mélange, ni une illusion, ni un homme divinisé. Il est une seule personne, mais en deux natures distinctes, humaine et divine, unies sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Ces quatre expressions deviendront la clé de voûte de la foi chrétienne.
Et Léon poursuit encore. « Il (le Christ) a été vraiment enfant, vraiment affamé, vraiment fatigué, vraiment crucifié. C’est son humanité. Et pourtant, c’est le Fils de Dieu, qui fait des miracles, ressuscite les morts et pardonne les péchés. » Dans ce tome, le pape accuse Eutychès d’orgueil et d’ignorance. Il cite les Écritures, les psaumes, les prophètes, Paul et Jean. Il redit que le salut exige que le Christ soit pleinement Dieu pour vaincre la mort, et pleinement homme pour pouvoir mourir.
Mais au moment où la lettre est envoyée, le rapport de force s’inverse. En août 449, l’empereur Théodose II convoque un concile à Éphèse pour réhabiliter Eutychès. L’évêque de Rome n’y est pas représenté, Flavien y est isolé, et les débats dégénèrent. Des moines armés font pression. Flavien est violemment agressé et mourra d’ailleurs peu après. Le concile, contrôlé par les partisans d’Eutychès, annule sa condamnation. On parle d’un latrocinium, un « concile de brigands ».
À quelque 2 000 kilomètres de là, Léon reste ferme. D’autant que des deux côtés de l’empire, sa lettre au défunt Flavien circule. Et deux ans plus tard, après la mort de Théodose, un nouveau concile est convoqué. Cette fois, à Chalcédoine.
Cet hiver 451, dans une église de l’actuelle Istanbul, la lettre de Léon est lue devant plus de 500 évêques. Le silence se fait. À la fin de la lecture, l’assemblée se serait écriée : « (L’Apôtre) Pierre a parlé par la bouche de Léon ! » Après avoir vérifié que les thèses du pape de Rome sont bien conformes à la pensée de la véritable autorité de l’époque, l’évêque Cyrille d’Alexandrie, le concile adopte les termes du tome comme base de la foi catholique.
Il rédige un nouveau texte, que l’on appelle encore l’horos (la définition de la foi) de Chalcédoine, reconnu aujourd’hui par les catholiques, les orthodoxes et les protestants. C’était il y a plus de 1 500 ans, mais outre quelques notes de bas de page, la définition n’a jamais été dépassée.
En 451, d’autres enjeux plus politiques sont lourds de tensions à venir entre Rome et Constantinople (1). Mais concernant la définition du dogme, ce qui se fonde là est un rôle spécifique de l’évêque de Rome : constituer un recours légitime lors des crises de la foi.
Source La Croix
Été 452, l’armée des Huns qui sème la terreur en Asie et en Europe depuis plusieurs décennies est aux portes de Rome. Le 8 juillet, afin de les convaincre d’épargner la ville, le pape Léon Ier (390-461) va à la rencontre de leur chef Attila (395-453) pour négocier.
– Certes, répond Attila. Mais l’orage ne saurait tarder avec cette chaleur.
Comme convenu, Léon revient deux jours plus tard. Cette fois, Attila souhaite s’entretenir seul avec lui. Les deux hommes discutent longuement, et les compagnons du pape prient, craignant pour l’avenir de la ville éternelle. Que se disent-ils ? Nul ne le sait. Mais Attila quitte Rome le 8 juillet.
Le roi des Huns s’est peut-être rendu compte de son âge avancé. Craint-il de ne pas pouvoir mourir dans ses terres natales ? Peut-être que l’épidémie qui se répand dans son armée l’effraie. Les superstitions ne manquent pas chez les Huns. Attila s’est-il rappelé Alaric, mort peu de temps après le pillage de Rome en 410 ? Léon est un homme sage et avisé. Il n’est pas impossible qu’il ait mené le roi des Huns à cette réflexion. Quoi qu’il en soit, Attila préfère repartir victorieux avec un butin conséquent. Rome est épargnée. De retour à la ville éternelle, le pape s’empresse de célébrer une messe d’action de grâce.
Publié le 24 mai 2025
Le Pape Léon Premier
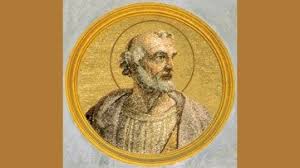
Tout commence à Constantinople, à la fin de l’année 448. Un moine influent, Eutychès, est convoqué par le patriarche Flavien. Le septuagénaire dirige un monastère respecté, près de la capitale de l’Empire romain d’Orient, mais son enseignement trouble : il affirme qu’il n’existe dans le Christ qu’une seule nature – divine – après l’Incarnation. Son raisonnement est simple : la divinité a absorbé l’humanité, comme la mer absorbe une goutte d’eau. La foi de Nicée, pour lui, est trop humaine.
Flavien le condamne. Le moine est déchu. Mais Eutychès ne s’avoue pas vaincu. Il fait appel à l’empereur Théodose II, dont il a les faveurs. Et surtout, il tente un geste inédit : il envoie un mémoire à Rome, demandant au pape de trancher. L’affaire bascule.
À Rome, le pape Léon, plus tard dit le Grand, comprend que ce débat ne relève pas seulement de la discipline. C’est toute la foi dans le mystère du Christ qui est en jeu. Le Verbe s’est-il vraiment fait chair ? Le salut est-il possible si le Christ n’a pas réellement partagé notre nature humaine ? L’évêque de Rome répond.
La lettre qu’il adresse au patriarche Flavien en juin 449 – le Tome à Flavien – est à la fois une réponse, un manifeste et un acte de gouvernement. Léon y soutient Flavien, mais il précise surtout la foi de l’Église : « Nous croyons que le Fils de Dieu est né de la Vierge Marie selon la chair, qu’il est vrai Dieu et vrai homme, parfait dans sa divinité, parfait dans son humanité », écrit Léon.
Il développe : le Christ n’est pas un mélange, ni une illusion, ni un homme divinisé. Il est une seule personne, mais en deux natures distinctes, humaine et divine, unies sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Ces quatre expressions deviendront la clé de voûte de la foi chrétienne.
Et Léon poursuit encore. « Il (le Christ) a été vraiment enfant, vraiment affamé, vraiment fatigué, vraiment crucifié. C’est son humanité. Et pourtant, c’est le Fils de Dieu, qui fait des miracles, ressuscite les morts et pardonne les péchés. » Dans ce tome, le pape accuse Eutychès d’orgueil et d’ignorance. Il cite les Écritures, les psaumes, les prophètes, Paul et Jean. Il redit que le salut exige que le Christ soit pleinement Dieu pour vaincre la mort, et pleinement homme pour pouvoir mourir.
Mais au moment où la lettre est envoyée, le rapport de force s’inverse. En août 449, l’empereur Théodose II convoque un concile à Éphèse pour réhabiliter Eutychès. L’évêque de Rome n’y est pas représenté, Flavien y est isolé, et les débats dégénèrent. Des moines armés font pression. Flavien est violemment agressé et mourra d’ailleurs peu après. Le concile, contrôlé par les partisans d’Eutychès, annule sa condamnation. On parle d’un latrocinium, un « concile de brigands ».
À quelque 2 000 kilomètres de là, Léon reste ferme. D’autant que des deux côtés de l’empire, sa lettre au défunt Flavien circule. Et deux ans plus tard, après la mort de Théodose, un nouveau concile est convoqué. Cette fois, à Chalcédoine.
Cet hiver 451, dans une église de l’actuelle Istanbul, la lettre de Léon est lue devant plus de 500 évêques. Le silence se fait. À la fin de la lecture, l’assemblée se serait écriée : « (L’Apôtre) Pierre a parlé par la bouche de Léon ! » Après avoir vérifié que les thèses du pape de Rome sont bien conformes à la pensée de la véritable autorité de l’époque, l’évêque Cyrille d’Alexandrie, le concile adopte les termes du tome comme base de la foi catholique.
Il rédige un nouveau texte, que l’on appelle encore l’horos (la définition de la foi) de Chalcédoine, reconnu aujourd’hui par les catholiques, les orthodoxes et les protestants. C’était il y a plus de 1 500 ans, mais outre quelques notes de bas de page, la définition n’a jamais été dépassée.
En 451, d’autres enjeux plus politiques sont lourds de tensions à venir entre Rome et Constantinople (1). Mais concernant la définition du dogme, ce qui se fonde là est un rôle spécifique de l’évêque de Rome : constituer un recours légitime lors des crises de la foi.
Source La Croix
Été 452, l’armée des Huns qui sème la terreur en Asie et en Europe depuis plusieurs décennies est aux portes de Rome. Le 8 juillet, afin de les convaincre d’épargner la ville, le pape Léon Ier (390-461) va à la rencontre de leur chef Attila (395-453) pour négocier.
– Certes, répond Attila. Mais l’orage ne saurait tarder avec cette chaleur.
Comme convenu, Léon revient deux jours plus tard. Cette fois, Attila souhaite s’entretenir seul avec lui. Les deux hommes discutent longuement, et les compagnons du pape prient, craignant pour l’avenir de la ville éternelle. Que se disent-ils ? Nul ne le sait. Mais Attila quitte Rome le 8 juillet.
Le roi des Huns s’est peut-être rendu compte de son âge avancé. Craint-il de ne pas pouvoir mourir dans ses terres natales ? Peut-être que l’épidémie qui se répand dans son armée l’effraie. Les superstitions ne manquent pas chez les Huns. Attila s’est-il rappelé Alaric, mort peu de temps après le pillage de Rome en 410 ? Léon est un homme sage et avisé. Il n’est pas impossible qu’il ait mené le roi des Huns à cette réflexion. Quoi qu’il en soit, Attila préfère repartir victorieux avec un butin conséquent. Rome est épargnée. De retour à la ville éternelle, le pape s’empresse de célébrer une messe d’action de grâce.
Publié le 24 mai 2025
Le Pape Léon Premier

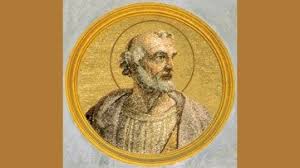
Tout commence à Constantinople, à la fin de l’année 448. Un moine influent, Eutychès, est convoqué par le patriarche Flavien. Le septuagénaire dirige un monastère respecté, près de la capitale de l’Empire romain d’Orient, mais son enseignement trouble : il affirme qu’il n’existe dans le Christ qu’une seule nature – divine – après l’Incarnation. Son raisonnement est simple : la divinité a absorbé l’humanité, comme la mer absorbe une goutte d’eau. La foi de Nicée, pour lui, est trop humaine.
Flavien le condamne. Le moine est déchu. Mais Eutychès ne s’avoue pas vaincu. Il fait appel à l’empereur Théodose II, dont il a les faveurs. Et surtout, il tente un geste inédit : il envoie un mémoire à Rome, demandant au pape de trancher. L’affaire bascule.
À Rome, le pape Léon, plus tard dit le Grand, comprend que ce débat ne relève pas seulement de la discipline. C’est toute la foi dans le mystère du Christ qui est en jeu. Le Verbe s’est-il vraiment fait chair ? Le salut est-il possible si le Christ n’a pas réellement partagé notre nature humaine ? L’évêque de Rome répond.
La lettre qu’il adresse au patriarche Flavien en juin 449 – le Tome à Flavien – est à la fois une réponse, un manifeste et un acte de gouvernement. Léon y soutient Flavien, mais il précise surtout la foi de l’Église : « Nous croyons que le Fils de Dieu est né de la Vierge Marie selon la chair, qu’il est vrai Dieu et vrai homme, parfait dans sa divinité, parfait dans son humanité », écrit Léon.
Il développe : le Christ n’est pas un mélange, ni une illusion, ni un homme divinisé. Il est une seule personne, mais en deux natures distinctes, humaine et divine, unies sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Ces quatre expressions deviendront la clé de voûte de la foi chrétienne.
Et Léon poursuit encore. « Il (le Christ) a été vraiment enfant, vraiment affamé, vraiment fatigué, vraiment crucifié. C’est son humanité. Et pourtant, c’est le Fils de Dieu, qui fait des miracles, ressuscite les morts et pardonne les péchés. » Dans ce tome, le pape accuse Eutychès d’orgueil et d’ignorance. Il cite les Écritures, les psaumes, les prophètes, Paul et Jean. Il redit que le salut exige que le Christ soit pleinement Dieu pour vaincre la mort, et pleinement homme pour pouvoir mourir.
Mais au moment où la lettre est envoyée, le rapport de force s’inverse. En août 449, l’empereur Théodose II convoque un concile à Éphèse pour réhabiliter Eutychès. L’évêque de Rome n’y est pas représenté, Flavien y est isolé, et les débats dégénèrent. Des moines armés font pression. Flavien est violemment agressé et mourra d’ailleurs peu après. Le concile, contrôlé par les partisans d’Eutychès, annule sa condamnation. On parle d’un latrocinium, un « concile de brigands ».
À quelque 2 000 kilomètres de là, Léon reste ferme. D’autant que des deux côtés de l’empire, sa lettre au défunt Flavien circule. Et deux ans plus tard, après la mort de Théodose, un nouveau concile est convoqué. Cette fois, à Chalcédoine.
Cet hiver 451, dans une église de l’actuelle Istanbul, la lettre de Léon est lue devant plus de 500 évêques. Le silence se fait. À la fin de la lecture, l’assemblée se serait écriée : « (L’Apôtre) Pierre a parlé par la bouche de Léon ! » Après avoir vérifié que les thèses du pape de Rome sont bien conformes à la pensée de la véritable autorité de l’époque, l’évêque Cyrille d’Alexandrie, le concile adopte les termes du tome comme base de la foi catholique.
Il rédige un nouveau texte, que l’on appelle encore l’horos (la définition de la foi) de Chalcédoine, reconnu aujourd’hui par les catholiques, les orthodoxes et les protestants. C’était il y a plus de 1 500 ans, mais outre quelques notes de bas de page, la définition n’a jamais été dépassée.
En 451, d’autres enjeux plus politiques sont lourds de tensions à venir entre Rome et Constantinople (1). Mais concernant la définition du dogme, ce qui se fonde là est un rôle spécifique de l’évêque de Rome : constituer un recours légitime lors des crises de la foi.
Source La Croix
Été 452, l’armée des Huns qui sème la terreur en Asie et en Europe depuis plusieurs décennies est aux portes de Rome. Le 8 juillet, afin de les convaincre d’épargner la ville, le pape Léon Ier (390-461) va à la rencontre de leur chef Attila (395-453) pour négocier.
– Certes, répond Attila. Mais l’orage ne saurait tarder avec cette chaleur.
Comme convenu, Léon revient deux jours plus tard. Cette fois, Attila souhaite s’entretenir seul avec lui. Les deux hommes discutent longuement, et les compagnons du pape prient, craignant pour l’avenir de la ville éternelle. Que se disent-ils ? Nul ne le sait. Mais Attila quitte Rome le 8 juillet.
Le roi des Huns s’est peut-être rendu compte de son âge avancé. Craint-il de ne pas pouvoir mourir dans ses terres natales ? Peut-être que l’épidémie qui se répand dans son armée l’effraie. Les superstitions ne manquent pas chez les Huns. Attila s’est-il rappelé Alaric, mort peu de temps après le pillage de Rome en 410 ? Léon est un homme sage et avisé. Il n’est pas impossible qu’il ait mené le roi des Huns à cette réflexion. Quoi qu’il en soit, Attila préfère repartir victorieux avec un butin conséquent. Rome est épargnée. De retour à la ville éternelle, le pape s’empresse de célébrer une messe d’action de grâce.
Dans ce dossier
Publié le 24 mai 2025